À la loupe :
Gil Jourdan - LE CHINOIS À DEUX ROUES
de Maurice TILLIEUX
Avertissement : Ce texte est la version intégrale d'un commentaire de planche paru dans la revue en ligne Neuvième Art 2.0 : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article460
Le rythme en bande dessinée
intervient différemment que dans les autres arts de la narration, parce que son
rapport au temps est plus ambivalent. Au cinéma par exemple, les images d’une
séquence (la scène) se succèdent dans la durée, et il est ainsi aisé de leur
imprimer des variations de rythme (accélération ou ralentissement), que ce soit
à travers le montage ou même dans l’intervention directe sur la vitesse de
projection de l’image. La bande dessinée présente au contraire une séquence (la
planche) dans une certaine simultanéité figée : c’est ce qu’on appelle la
tabularité, cet espace de la page dans lequel l’œil perçoit collectivement les
cases qui s’y succèdent et qui présentent un récit dans la durée, certes, mais
seulement la durée de notre lecture. Ce n’est dès lors plus le temps du récit
qui défile comme dans un film, mais les espaces du récit (les cases) qui s’y
succèdent. On comprendra, dès lors, que
le rythme en bande dessinée est plutôt une affaire d’espace que de temps.
C’est ce que démontre de manière
exemplaire cette planche extraite du Chinois
à deux roues, une aventure de Gil Jourdan. Dans cette page, on est arrivé au
terme d’une course poursuite, et ce topos du récit policier est l’occasion rêvée
pour Tillieux de se mesurer à la question du rythme. La planche se divise en
deux parties : d’abord quatre cases qui occupent la première moitié de la
page, et puis une très grande case à laquelle est consacrée toute la deuxième
moitié. La première bande se focalise sur le véhicule des poursuivants, la
deuxième sur la camionnette du poursuivi (Jourdan), et la grande case enfin sur
leur rencontre brutale.
Si l’on compare ces deux parties
et ce qui s’y passe, on comprend vite que l’intention du dessinateur est de
donner l’impression d’une précipitation du récit, une montée en intensité qui
trouve son paroxysme à la dernière case. Les quatre premières offrent ainsi des
instantanés de l’action très « serrés », très proches les uns des
autres, comme le montre leur articulation. En effet, le bandit n’a pas le temps
de finir sa phrase dans la première vignette, ni même le verbe qu’il a pourtant
commencé à prononcer, et qui débute par un « f » – à la case
suivante, il hurle avec désespoir au conducteur « frEINE !!
FREINE !! », injonction qui reprend donc la première lettre du verbe
avorté de sa précédente réplique : la parole est alors saisie dans une
continuité fluide, en un seul et même élan glissant d’une case à l’autre. La vitesse est suggérée de manière plus
visuelle dans la deuxième bande où l’on voit d’abord Jourdan sauter par la
portière de la camionnette en marche, et puis celle-ci poursuivre sa course en
s’éloignant alors que le héros n’est plus qu’à peine visible au bord de la
case : Tillieux donne ainsi l’impression d’avoir conservé
approximativement le même cadrage d’une vignette à l’autre, la dérive des deux
objets (le véhicule vers le point de fuite, Gil Jourdan vers le hors-champ)
s’expliquant par la rapidité et la brutalité de l’enchaînement. La dernière
case représente alors les deux véhicules qui se rentrent l’un dans l’autre, de
manière doublement spectaculaire : d’abord en raison du choc qui a lieu,
et puis par rapport à la place qui lui est accordée sur la planche, aux
dimensions disproportionnées.
A travers la gestion de l’espace,
on obtient donc deux rythmes différents : d’abord un précipité de l’action
grâce un enchaînement de cases de taille standard, qui figure l’accélération, et
puis une suspension, un peu comme un ralenti, avec cette case démesurée qui semble
freiner le temps de la lecture, obligeant le lecteur à s’y arrêter plus
longuement pour en considérer toute l’importance. Le récit n’est que la pure
allégorie de ce travail sur le rythme, avec ses voitures qui roulent à tombeau
ouvert dans la première partie, et qui se voient violemment immobilisés dans la
deuxième.
Entre vitesse et arrêt,
précipitation et suspension, l’espace apparaît alors certes comme vecteur du
rythme en bande dessinée, mais aussi en instrument de la dislocation : dislocation
temporelle évidemment, puisque chaque case est un instant différent, mais aussi
dislocation physique, les espaces se télescopant sur la page. Il n’y a qu’à
observer ici la désorientation que traduisent les personnages et qui brouille
la hiérarchie du sens de lecture. En effet, dans l’espace diégétique, les
bandits sont en bas et Gil Jourdan en haut ; sur la planche, c’est le
contraire. De plus, dans la première bande, les bandits regardent vers le haut,
tandis qu’à la deuxième bande le détective a les yeux baissés vers le bas et
que la camionnette est précipitée dans le vide. Ainsi, les valeurs sont
renversées, le haut en bas et le bas en haut, les regards bifurquant dans
chaque sens alors qu’ils devraient se croiser… La précipitation du rythme a
donc pour corolaire la désarticulation des espaces physiques, mis sens dessus
dessous.
A cela s’ajoute la pratique du
surcadrage, les vitres et les portières de chaque véhicule renvoyant en abyme
aux cadres des cases elles-mêmes, véhicules du récit : à la fin, ces
cadrages intérieurs à l’image se percutent et se télescopent au sein d’une
seule case dans laquelle s’incarne le chaos : tôle froissée, portières
éjectées, glaces brisées, pneus écrasés, personnage entre l’intérieur et
l’extérieur, à deux doigts d’être broyé – un coup de feu part même tout seul.
Là, la dislocation ne se réalise pas d’une case à l’autre, mais se poursuit à
l’intérieur-même de cette dernière case, jonction de toutes les forces
contraires, collision destructrice d’espaces autonomes.

http://www.dupuis.com/catalogue/FR/s/2643/gil_jourdan_-_l_integrale.html
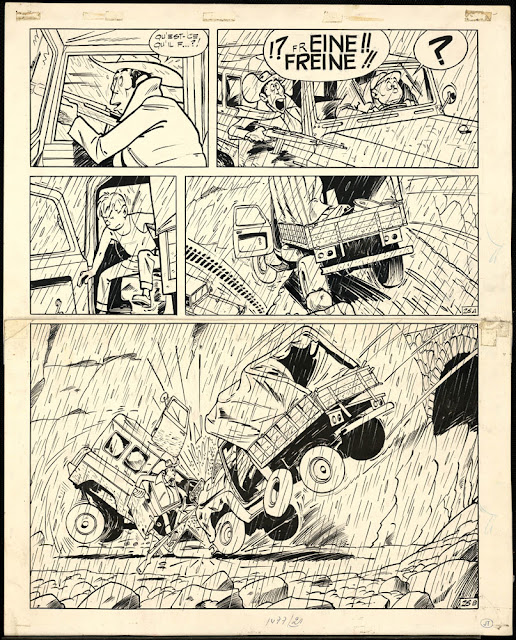
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire